L’imagination survivante : l’appauvrissement de l’expérience sensible
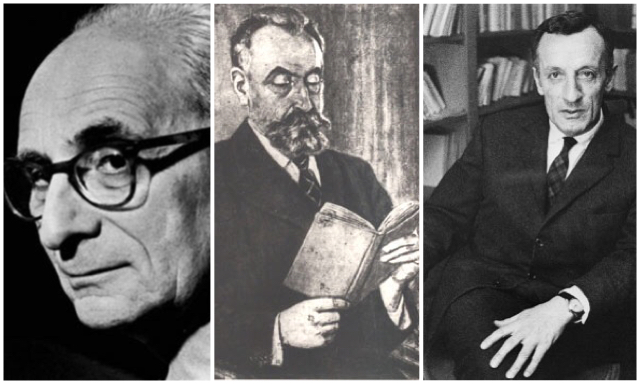
Résumé Ce que Charles Melman désigne par la « liquidation collective du transfert » définit assez justement l’état paradoxal dans lequel nous nous trouvons : les progrès techniques et scientifiques ont à la fois ouvert un immense espace de liberté, mais ils ont entraîné en même temps une perte de référence et d’autorité. Qu’est-il devenu de notre vie imaginative et affective ? Comment assurer le maintien d’une vie sensible au-delà des énigmes de la pensée ?
Mots-clés Barbarie – expérience – lien – pneuma – réel
Abstract What Charles Melman defines as the “liquidation collective du transfert” (i.e. “the collapse of Human masses empathy”) clearly describes the paradoxical state in which we are : on the one hand, technical and scientific breakthroughs have opened a wide area of freedom but, on the other hand, they have also led to a loss of reference and authority. What happened to our imaginative and emotional life ? How is it possible to nurture our sensitivity despite the intricate maze of human thought ?
Key-words Barbarity – breath – experience – link – reality
La résistance du réel
Réfléchir à la survivance de l’imagination dans la sphère de nos expériences conduit à nous poser la question suivante : l’imagination se définit-elle encore aujourd’hui comme puissance de connaissance – auquel cas elle constituerait toujours la matrice fondamentale permettant une convertibilité entre nos impressions et nos idées – ou n’est-elle pas reconnue à l’inverse dans son opposition avec la réalité concrète ? En effet, devant l’insistance d’un réel devenu douloureux voire insoutenable, le recours à l’imagination semble opérer une forme de transaction avec l’effectivité de l’événement (qui ne peut souffrir d’aucun compromis) afin de l’expulser hors de notre regard. Pour autant, il ne s’agit pas ici de nier ou de détruire l’objet réel dans la mesure où ce dernier est singulier, c’est-à-dire tel qu’aucune représentation ne peut en suggérer de connaissance ou d’appréciation directe : « si la réalité peut être cruelle, elle n’en est pas moins réelle »[1]. Ainsi, la vivacité d’une impression partage le sort commun de toute expérience de la réalité, d’être seulement immédiate. Il s’agit alors de limiter notre exposition au réel et d’instaurer une médiation dont le but premier consiste à suspendre notre tolérance à l’égard du réel en frayant la voie possible de son détournement, et cela pour lui substituer une réalité concurrente (fictive) par le biais de la réplique. Ce processus de remplacement conditionne l’intervention de l’imagination qui modifie alors la trajectoire de notre perception et nous dérobe littéralement l’objet qu’elle était sur le point d’atteindre. Si la finalité de ce tour d’esprit tend à nous préserver de l’hostilité du réel dans ses manifestations brutales, elle suscite indirectement la remise en question de l’intégralité de la réalité du monde en général. En effet, les moyens de cette évasion sont en passe de s’offrir à nous comme la seule adéquation de notre présence au monde, laquelle se nourrit de notre méfiance à l’égard des choses qui nous entourent : « Voir juste n’est pas une condition suffisante pour voir le réel, si l’on est pas assuré de voir quelque chose »[2]. Précisément, ce « quelque chose » associé à l’acte même de percevoir ajoute une surdétermination à l’objet et emporte notre jugement au profit de la suggestion de ce qui n’est pas, ou plus exactement envisage l’objet dans une certaine modalité d’être :
Le caractère de l’existence d’une chose ne peut absolument se trouver dans son seul concept ; car, quoique le concept soit si parfait qu’il n’y manque absolument rien pour penser une chose avec toutes ses déterminations internes, il n’y a rien de commun entre l’existence et ces déterminations.[3]
Il se dresse alors un impératif catégorique dans l’exercice de notre pensée qui veut que le réel survive quoiqu’il advienne, alors même que rien n’est plus fragile que la faculté humaine d’admettre la réalité. Mais à trop chercher à nous prémunir de la force vive du réel et à l’esquiver, ne manquons-nous pas tout simplement le réel ? Et n’est-il pas dès lors confiné uniquement dans l’après coup de son événement, autrement dit dans tout ce qui survit de manière opaque à notre conscience et délibérément soustrait à une saisie intuitive par la pensée ? Le refoulement est le processus qui maintient en captivité ce surplus de signification (habituellement réparti entre les choses selon les lois de la pensée symbolique)[4] et que l’individu canalise de manière méthodique et rigoureuse dans les limites de l’expansion de sa connaissance des phénomènes. Un réel refoulé est une image qui persiste sur le mode de l’impression en contredisant toute possibilité de représentation, c’est-à-dire de mise à distance du sentiment de ce qui est réel.
Pensée et échange symbolique
La question restant ouverte, elle cherche à déterminer si nous avons ardemment choisi ou non de vivre dans ce monde réglé sous la coupe de notre raison. Marcel Mauss a été l’un des premiers à faire éclater les cadres rigides de la psychologie et de la logique traditionnelles (son essai sur la magie est antérieur à la diffusion étendue des idées de Freud) en révélant d’autres formes de pensée, en apparence en contradiction profonde avec ce qu’il nomme nos « entendements d’adultes européens »[5]. En effet, il a montré que la magie comprise comme l’intersection entre le raisonnement analogique (l’association des idées) et l’expérience individuelle de la conscience et du rêve, était à la base de nos représentations collectives qui sont devenues depuis les fondements de l’esprit humain : « Si éloignés que nous pensions être de la magie, nous en sommes encore mal dégagés »[6]. Le scepticisme destructeur de David Hume assoit totalement la démonstration de Mauss dans le sens où ce dernier met hors de portée du raisonnement la relation de causalité, celle-là même qui nous assure de la réalité d’une existence et d’un fait au-delà du témoignage des sens ou des rapports de notre mémoire. Il est en effet impossible de découvrir sans le recours à l’expérience et par la seule opération de notre raison, la relation qui unit les qualités sensibles d’un objet et ses pouvoirs cachés : « toutes nos conclusions expérimentales se tirent de la supposition que le futur sera conforme au passé »[7]. Ces deux approches constituent les deux faces d’une même pièce et dessinent les contours de la croyance qui instruit notre rapport au monde :
Toutes les fois qu’un objet se présente à la mémoire ou aux sens, immédiatement, par la force de l’accoutumance, il porte l’imagination à concevoir l’objet qui lui est habituellement conjoint […] C’est en cela que consiste toute la nature de la croyance.[8].
Telle est devenue aujourd’hui notre manière de concevoir la réalité, dans le filtre d’une conjonction coutumière de l’objet avec un souvenir présent à la mémoire et aux sens. C’est la nature même de ce glissement qu’il nous faut interroger car il arrive parfois que l’anesthésie générale qui nous maintient dans le réel ne suffise plus à étouffer ses manifestations, son insistance à être perçu. En effet, que le réel nous incite à la nausée ou à l’exaltation, le sentiment d’existence se lie immanquablement à un élément de surprise qui vient perturber le cours ordinaire de la causalité. L’étonnement qui nous saisit face à un objet inconnu pour n’avoir pas été déjà expérimenté, est le même que celui susceptible de surgir à l’occasion de la rencontre avec n’importe quel autre objet – que nous estimons par ailleurs familier – et dont nous éprouvons pourtant la présence singulière. C’est dans cette fulgurance, dans cet « éclair de l’être » qu’il nous faut repenser les mots d’Héraclite : « Les choses manifestes que nous avons prises, nous les laissons ». Si les objets du monde sensible possèdent bien une corporéité, nous nous abusons en transformant l’expérience de nos sens en des impressions permanentes suivant le principe d’accoutumance décrit par Hume. En dehors de nous, c’est-à-dire en dehors de l’appréhension sensorielle que nous exerçons, il n’y a pas de fleuve mais seulement une « sensation fugitive en nous à laquelle nous donnons le nom de fleuve »[9].Nos expériences sensibles soutiennent toute la multiplicité du monde et nous plongent dans un entrelacs d’énigmes que répète la parole du sage. Ce lien d’esprit avec la matière soulève l’intuition que tous les hommes peuvent le connaître et qu’il n’est pas le fruit de notre imagination visant à déséquilibrer le rapport entre le monde réel et une réalité entièrement fantasmée, jusqu’à opposer farouchement ces deux régimes de présence.
Aux origines fantastiques du pouvoir et de l’emprise
En somme, n’avons-nous pas entrepris depuis le mouvement des Lumières de faire éclore la raison au prix exact de l’imagination, et ce afin de libérer la pensée de toute emprise superstitieuse, fanatique, despotique ? Bien sûr, les aspirations historiques profondes qui président à la conquête de la liberté humaine, c’est-à-dire à l’expression de l’individualité, sont non seulement légitimes mais elle sont portées par des siècles d’asservissement à une puissance sourde et prétendument « naturelle » qui exerça son autorité au-delà des frontières du corps et de l’esprit pour s’insinuer dans chaque replis de l’être. Par conséquent, il était tout à fait prévisible que le mouvement des Lumières porta son combat sur le dévoilement des sources fantastiques du pouvoir et de la puissance. En effet, comme le démontre si brillamment Hume dans son Enquête sur l’entendement humain, chaque idée de l’esprit humain procède par dérivation et copie d’une impression dite primitive ; ou en d’autres termes « qu’il nous est impossible de penser à quelque chose que nous n’ayons pas auparavant senti par nos sens, externes ou internes »[10]. Suivant ce schéma originel de la pensée et pour accéder à l’idée de pouvoir ou de connexion nécessaire, il nous faut remonter à l’impression originelle qui la fonde. Mais là réside l’entièreté du problème dans le fait que les idées de pouvoir, de force ou d’énergie demeurent à ce point obscures pour le raisonnement que seule l’expérience nous renseigne sur l’action de notre volonté ; et Hume vient à conclure alors que le pouvoir « n’est ni senti, ni connu, ni même concevable par l’esprit »[11]. Cette influence de la volonté nous la connaissons par la conscience (lorsque nous faisons surgir une nouvelle idée dans notre imagination) ; de plus la maîtrise de l’esprit sur lui-même aussi bien que sur le corps est limitée, et ces limites ne sont pas connues a priori par la raison. C’est en s’attaquant aux fondements imaginaires de la puissance et du pouvoir que le mouvement des Lumières parvint à émanciper les consciences en démontrant la virtualité de toute emprise « naturelle » ou de droit divin. Mais ce que le mouvement des Lumières semblait négliger, c’est que nous ne pourrons jamais détruire ce qui nous constitue qu’au prix de nous détruire nous-mêmes. Car si l’imagination est aux fondements du pouvoir, elle est également à la source de notre vie affective et émotionnelle ; et la condamner nous conduit à la voir resurgir sous une forme embryonnaire (la raison n’est au fond qu’un régime spécifique de l’imagination) dont le déploiement se trouvera considérablement réduit. Il est non seulement stérile d’opposer la raison à l’imagination, mais cela revient également à refuser de comprendre et d’admettre que « magie et science représentent en dernière instance des besoins imaginaires, et le passage d’une société à dominante magique vers une société à dominante scientifique s’explique en premier lieu par un changement de l’imaginaire »[12]. Mettre au jour les facteurs qui ont permis de produire cette modification de l’imagination humaine – depuis une définition de l’âme en tant que corps subtil et transmissible (chez les stoïciens) – nous ouvrira à une juste compréhension des origines et de l’essor de la science moderne, et nous permettra aussi d’exhumer les vestiges de l’idée de magie dont l’esprit humain est probablement incapable de se défaire et qui persiste dans la vertu des mots, l’efficacité des gestes, la puissance du regard. Car au fond de toute représentation, il apparaît que les hommes sont portés par une « tendance universelle à concevoir tous les êtres à leur ressemblance et à transférer à tous les objets les qualités auxquelles ils sont habitués et familiarisés et dont ils ont une conscience intime »[13].
L’imagination cataleptique
La pensée antique, d’une tradition issue d’Aristote, considérait l’imagination comme faculté de connaissance insérée entre la sensibilité et l’intellect. Plus généralement rattachée à l’ensemble des facultés qui concernent l’image, jusqu’à aboutir à la mémoire ou au jugement si l’on suit l’ordre des transformations intérieures, elle était essentiellement la fonction intermédiaire de la connaissance, comme « l’image est l’intermédiaire entre l’objet et le concept »[14]. On mesure alors la nécessité de recourir à l’opérateur dialectique qu’est l’imagination dès l’instant où l’esprit est exposé à son propre clivage interne, c’est-à-dire à un double mode d’apparition des phénomènes : les impressions et les idées. Le fait que l’esprit ne coïncide pas nécessairement avec lui-même dès l’instant où l’homme dispose d’un surplus de signification – qu’il doit alors redistribuer afin que « le signifiant disponible et le signifié repéré restent entre eux dans le rapport de complémentarité qui est la condition même de la pensée symbolique »[15] – nous contraint à soutenir une dualité permanente dans le rapport de l’esprit à ses pensées, ses apparitions, ses perceptions ou ses affections. Cet espace intermédiaire d’échanges et de fluctuations constitue le lieu privilégié où s’opèrent les conversions mutuelles entre impressions et idées : il s’agit précisément de l’imagination. Cela ne va pas sans poser un problème crucial dans le fonctionnement même de l’imagination puisque celle-ci opère constamment dans l’ambiguïté et la dualité depuis la scission primitive de l’esprit avec lui-même. L’imagination s’emploie à résorber cet écart constitutif entre deux modes d’appréhension et d’apparition suivant un processus d’abstraction : « Pour reconnaître un objet, il faut d’abord le percevoir, ce qui ne pourrait se réaliser que dans le synthétiseur […] La nature du synthétiseur est, bien entendu, pneumatique »[16]. En effet, si le fantasme est la modalité propre à l’homme pour accéder aux réalités intelligibles, il s’agit alors d’opérer une traduction en langage fantastique des réalités perçues sur le mode de l’impression. Car bien que le fantasme puisse se dispenser de tout rapport à un objet réel, il ne peut cependant pas faire l’économie – de par sa nature d’image – d’un support physique. C’est la raison pour laquelle une histoire à fantasmes reste toujours interprétable. La nature du lien qui unit une image aux circonstances de sa captation fait bien entendu écho à l’interprétation du rêve d’après Freud, lorsqu’il s’efforce de distinguer soigneusement le rêve manifeste des pensées latentes du rêve – qui ne se révèlent qu’à l’analyse. Et même quand le rêve apparaît comme incohérent et que le thérapeute ne parvient pas à prendre complètement connaissance des pensées latentes qui le soutiennent, il existe néanmoins une « corrélation intime […] entre le caractère inintelligible et confus du rêve et les difficultés que soulève la communication des pensées du rêves »[17]. Le fait que contenu manifeste et contenu latent puissent ne pas coïncider s’explique à partir du travail de condensation du rêve qui consiste en la création de pensées intermédiaires, lesquelles forment certaines composantes de son contenu « qui lui sont particulières et ne se trouvent pas dans la pensée éveillée »[18]. Telle la production des individus collectifs et composites qui vise à établir entre les personnes originales une équation sous un certain rapport. Cette propriété du rêve recoupe l’intuition des premières sociétés humaines qui fondent l’interdépendance des individus au sein d’une force spirituelle antérieure à toute séparation. En effet, par le passé un clan ou une tribu s’agrégeait autour d’un mythe d’origine, assurant ainsi la distribution des rôles et des ascendances : « la perpétuité des choses et des âmes n’est assurée que par la perpétuité des noms des individus, des personnes »[19]. Si l’imagination intervient dans un processus d’abstraction et de conversion, c’est suivant la tentative de retrouver une unité perdue, celle de l’esprit qui ne se comprend pas lui-même, unité qui précisément nous façonnait dans notre animalité et ne s’oppose aucunement avec notre devenir humain (Albert le Grand associe l’imagination à l’instinct animal dans son De anima). La saisie du monde par l’imagination n’ouvre pas sur quelque chose d’autre par rapport au milieu et à la vie animale, et c’est justement parce que « le monde ne s’est ouvert pour l’homme que par la suspension et la capture de la vie animale que l’être est toujours déjà traversé par le néant »[20]; autrement dit, l’homme ne pourra jamais que procéder à des recoupements et définir des appartenances au sein d’une totalité fermée et complémentaire avec elle-même.
L’appauvrissement de l’expérience
La science moderne a profondément modifié la relation de l’homme avec ses propres fantasmes, et l’évolution de cette relation est marquée par des raisons idéologiques qui ont conduit à une censure radicale de l’imaginaire. Ce que nous avons acquis d’un côté (connaissances scientifiques et technologie innovante), nous le perdons de l’autre. Excepté que nous n’éprouvons pas la perte d’opérer activement avec nos propres fantasmes comme laissant un vide profond à l’endroit de notre vie émotionnelle et affective. Le dernier état de l’évolution du scepticisme se laisse réduire à deux traits essentiels qui sont la confiance maintenue à l’endroit des phénomènes et surtout, le fait que le crédit accordé à la vie et à l’expérience s’accompagne « d’un refus de l’activité spéculative et dogmatique, qui conduit au silence et à la tranquillité de l’âme »[21]. Le scepticisme tardif vient alors donner consistance à une idée farouchement combattue durant la Renaissance (période pendant laquelle on réinvestit les intuitions de la pensée grecque et antique), celle d’une séparation des « affections nécessaires du corps et la partie supérieure de l’âme, siège de la mémoire »[22]. Alors que toutes les « sciences » de la Renaissance avaient pour matériel de construction le fantasme, la Réforme protestante dans un mouvement radicalement conservateur abrogea le culte des images et condamna le caractère idolâtre des fantasmes, au point de produire une modification substantielle de l’imagination humaine. Toute la civilisation occidentale est traversée violemment par ce courant réformateur qui impose une censure de l’imaginaire et aboutit à l’apparition de la science exacte et de la technologie moderne sur le plan théorique. Plus encore, c’est un fait que l’humanité tient désormais pour acquis et qui ne souffre d’aucune hésitation : l’imaginaire et le réel sont deux domaines distincts et il ne peut y avoir d’échanges entre eux, autrement dit l’imagination ne peut pas avoir de force réelle, ce qui conduit la pensée à une négation du principe de la magie et de la dialectique de l’éros. Dès cet instant, nous considérerons sur le seul critère de la possession tout ce qui est susceptible de faire défaut à l’équilibre de notre vie physique et psychique, ou plus exactement nous emporterons la conviction que le principe de réalité triomphe sur le principe de plaisir. Mais malgré cette disposition, nous continuons encore aujourd’hui (et souvent sans même nous en rendre compte) à souffrir de cette privation de la puissance imaginaire qui nous persuade, par exemple, que l’apaisement du désir érotique n’est pas réel dès lors qu’il est fantastique. En d’autres termes, nous sommes profondément embarrassés à l’idée que le sentiment amoureux ou poétique puisse transfigurer la réalité, c’est-à-dire qu’il produise dans notre vie éthique et imaginative des effets concrets ; à l’unique exception qu’il soit recueilli dans une sorte de dialogue commun de façon à être légitimé et admis. Telle est la nature intime de la « société du spectacle » qui propose une unité fictive des phénomènes apparents en concentrant tout regard et toute conscience. Les passions et les affections s’y déroulent sur le mode de la représentation, dans la soumission à un modèle préétabli : le « spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant »[23].Ce qui devait constituer clairement une menace du temps de Charles Baudelaire, qui s’interroge dans son Salon de 1859 sur l’importance que le XXe siècle allait accorder à l’essor de la technique (citant la photographie) ; le fait que cette dernière risquait de corrompre notre disposition à percevoir le monde en atténuant nos facultés de juger et de sentir, réapparaît moins d’un siècle plus tard (en 1933) sous la forme explicite d’une revendication :
Pauvreté d’expérience : il ne faut pas comprendre cela comme si les hommes aspiraient à une nouvelle expérience. Non, ils aspirent au contraire à se libérer de l’expérience, ils aspirent à un environnement dans lequel ils puissent mettre en valeur leur pauvreté de façon pure et explicite – leur pauvreté extérieure et finalement aussi leur pauvreté intérieure – de telle sorte qu’il en ressorte quelque chose de respectable.[24]
Privés de cette suture imaginaire que permet l’expérience sensible, comment pouvons-nous dès lors faire le lien entre l’objet et le concept ? En consentant à supporter un sentiment de « peu de réalité » (André Breton) et en acceptant que notre ouverture au monde est illusoire ou indirecte, et que ce que nous voyons n’est pas le monde même. Mais, étrangement, nous ne semblons pas souffrir de ce rendez-vous manqué avec le réel car bientôt happés par le sommeil, il n’est pas rare que « le rêve dédommage de la tristesse et du découragement du jour et montre réalisée l’existence toute simple mais grandiose pour laquelle, dans le monde éveillé, la force manque »[25]. Et si nous demandons malgré tout au réel de persister en son état ordinaire, d’une singularité qui se suffit à elle-même, alors soudainement Dieu se retire du monde et nous nous heurtons à un silence effrayant (l’infini de Pascal) : « Ce “silence de dieu” est, en réalité, silence du monde, silence de la nature »[26]. Toute évasion étant devenue dès lors inconcevable – puisque le réel contient la totalité de ce qui existe et se comprend lui-même –, il ne reste plus qu’une seule conduite possible : celle de « prendre à la lettre ce que nous enseigne la vision : que par elle nous touchons le soleil, les étoiles, nous sommes en même temps partout, aussi près des lointains que des choses proches, et que notre pouvoir de nous imaginer ailleurs […] emprunte encore à la vision »[27]. Cette manière d’être au monde se réinvente à chaque instant de notre vie mais pour autant, pouvons-nous encore souscrire à l’affirmation utopique de Walter Benjamin qui tente d’introduire positivement le concept de barbarie, dans le sens où la pauvreté d’expérience mène le barbare à « recommencer de nouveau, s’en sortir avec peu, reconstruire avec peu »[28]? Il semblerait que l’homme qui vient se découvre sans pesanteur, sans grâce, et soit incapable de vivre dans un monde qui prend si vite l’apparence de la montée et de la chute :
Qui étions-nous devant la réalité, cette réalité que je sais maintenant couchée aux pieds de Nadja, comme un chien fourbe ? Sous quelle latitude pouvions-nous bien être, livrés ainsi à la fureur des symboles, en proie au démon de l’analogie […] D’où vient que projetés ensemble, nous ayons pu échanger quelques vues incroyablement concordantes par-dessus les décombres fumeux de la vielle pensée et la sempiternelle vie ?[29]
Clément Bodet
Aix-Marseille Université / Laboratoire d’Études en Sciences des Arts (LESA)
Bibliographie
AGAMBEN Giorgio, L’Ouvert, De l’homme à l’animal, traduction de l’italien par Joël Gayraud, Paris, Éd. Payot & Rivages, 2006.
BENJAMIN Walter, Expérience et pauvreté, traduction de l’allemand par Cédric Cohen Skalli, Paris, Éd. Payot & Rivages, 2011.
BRETON André, Nadja, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2013.
COLLI Giorgio, La Naissance de la philosophie, traduction de l’italien par Patricia Farazzi, Paris, Éd. de l’éclat, 2004.
COULIANO Ioan Peter, Éros et magie à la Renaissance, Paris, Flammarion, 1984.
DEBORD Guy, La Société du Spectacle, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1992.
DUMONT Jean-Paul, Le scepticisme et le phénomène, Paris, Librairie philosophie J. Vrin, 1972.
FREUD Sigmund, Sur le rêve, traduction de l’allemand par Cornélius Heim, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2010.
HUME David, Enquête sur l’entendement humain, traduction de l’anglais par André Leroy, Paris, Éd. Montaigne, 1947.
—, L’Histoire naturelle de la religion, traduction de l’anglais par Michel Malherbe, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1996.
KANT Emmanuel, La critique de la raison pure, traduction de l’allemand par C. J. Tissot, Tome premier, Paris, Librairie de Ladrange, 1835.
KLEIN Robert, « L’imagination comme vêtement de l’âme chez Marsile Ficin et Giordano Bruno » dans Revue de Métaphysique et de Morale, Janvier-Mars 1956, n°1.
MAUSS Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.
MERLEAU-PONTY Maurice, L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2003.
ROSSET Clément, L’École du réel, Paris, Éd. de minuit, 2008.
POUR CITER CET ARTICLE Clément Bodet, « L’imagination survivante : l’appauvrissement de l’expérience sensible », Nouvelle Fribourg, n. 2, octobre 2016. URL : https://www.nouvelle-fribourg.com/archives/limagination-survivante-lappauvrissement-de-lexperience-sensible/
NOTES
1Clément Rosset, L’École du réel, Paris, Éd. de Minuit, 2008, p. 19.
2 Ibid., p. 102.
3 Emmanuel Kant, La critique de la raison pure, Tome premier, Paris, Librairie de Ladrange, 1835, p. 315.
4 Claude Lévi-Strauss, « Introduction à l’œuvre de M. Mauss » dans Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F, 2012, p. 49.
5 Marcel Mauss, « Esquisse d'une théorie générale de la magie » dans Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F, 2012, p. 100.
6 Ibid., p. 137.
7 David Hume, Enquête sur l'entendement humain, Paris, Éd. Montaigne, 1947, p. 81.
8 Ibid., p 94-95.
9 Giorgio Colli, La Naissance de la philosophie, Paris, Éd. de l'éclat, 2004, p. 64.
10 David Hume, op. cit., p. 108.
11David Hume, op. cit., p. 115.
12 Ioan Peter Couliano, Éros et magie à la Renaissance, Paris, Flammarion, 1984, p. 17.
13 David Hume, L’Histoire naturelle de la religion, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1996, p. 48.
14 Robert Klein, « L'imagination comme vêtement de l'âme chez Marsile Ficin et Giordano Bruno » dans Revue de Métaphysique et de Morale, Janvier-Mars 1956, n° 1, p. 19.
15 Claude Lévi-Strauss, op.cit., p. 49.
16 Ioan Peter Couliano, op.cit., p. 160.
17 Sigmund Freud, Sur le rêve, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2010, p. 65.
18 Ibid., p. 78.
19 Marcel Mauss, « Une catégorie de l'esprit humain : la notion de personne, celle de "moi" » dans Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F, 2012, p. 350.
20 Giorgio Agamben, L'Ouvert, De l'homme à l'animal, Paris, Éd. Payot & Rivages, 2006, p. 127.
21 Jean-Paul Dumont, Le scepticisme et le phénomène, Paris, Librairie philosophie J. Vrin, 1972, p. 11.
22 Ibid.
23 Guy Debord, La Société du Spectacle, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1992, p. 16.
24 Walter Benjamin, Expérience et pauvreté, Paris, Éd. Payot & Rivages, 2011, p. 46.
25 Ibid. p. 47. (à noter que l'on pourrait parfaitement remplacer le terme de « rêve » dans la citation de Benjamin par celui de « spectacle » ou de « société de consommation » qui sont autant d'objets compensatoires à même de négocier un apaisement temporaire de notre condition d'esclave moderne : « Rien ne sert d'être vivant, le temps qu'on travaille », André Breton, Nadja, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2013, p. 69.)
26 Ioan Peter Couliano, op. cit., p. 274.
27 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l'Esprit, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2003, p. 83-84.
28 Walter Benjamin, op., cit., p. 41.
29 André Breton, Nadja, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2013, p. 128-131.


